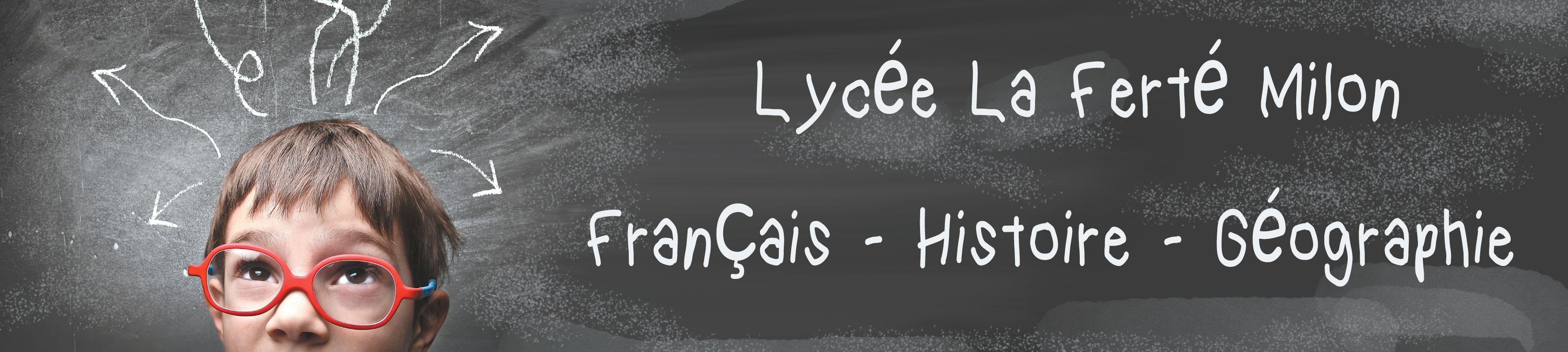
|
Publication : 19/06/2018 | Mise à jour : 19/06/2018 |
Terminale Bac Pro - C. Carré |
Tweet |
|
|
Français : |
L'Étranger - Albert CAMUS |
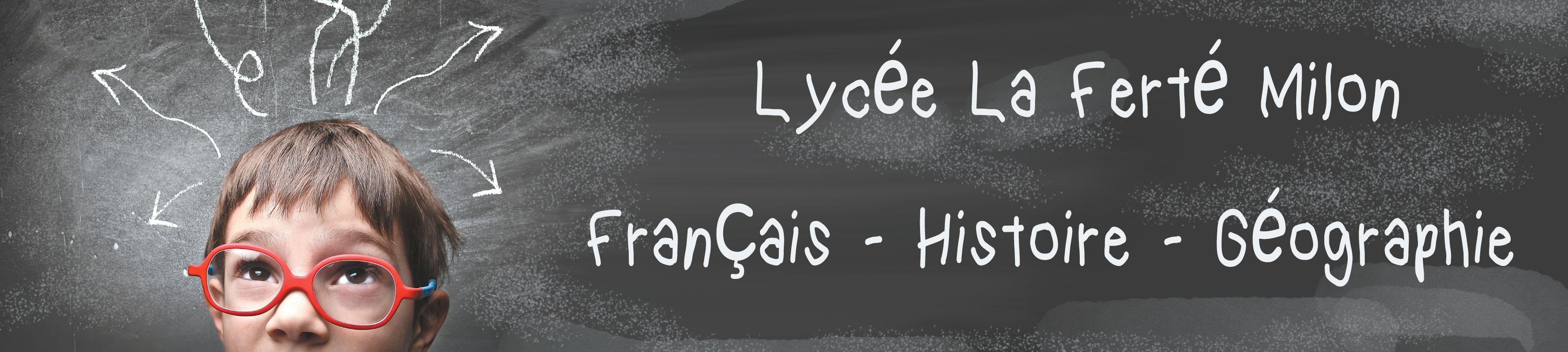
|
Publication : 19/06/2018 | Mise à jour : 19/06/2018 |
Terminale Bac Pro - C. Carré |
Tweet |
|
|
Français : |
L'Étranger - Albert CAMUS |
|
Titre : L'Étranger Auteur : Albert CAMUS Année d'édition : 1942 123 pages / 2 parties quasi égales/ 5 chapitres chacune Personnage principal : Meursault (pas de prénom)
|
Le résumé du roman
Le roman met en scène un personnage-narrateur nommé Meursault, vivant à Alger en Algérie française. Au début de la première partie, Meursault reçoit un télégramme annonçant que sa mère, qu'il a internée à l’hospice de Marengo, vient de mourir. Il se rend en autocar à l’asile de vieillards, situé près d’Alger. Veillant la morte toute la nuit, il assiste le lendemain à la mise en bière et aux funérailles, sans avoir l'attitude à attendre d’un fils endeuillé ; le héros ne pleure pas, il ne veut pas simuler un chagrin qu'il ne ressent pas. Le lendemain de l'enterrement, Meursault décide d'aller nager à l'établissement de bains du port, et y rencontre Marie, une dactylo qui avait travaillé dans la même entreprise que lui. Le soir, ils sortent voir un film de Fernandel au cinéma et passent le restant de la nuit ensemble. Le lendemain matin, son voisin, Raymond Sintès, un proxénète notoire, lui demande de l'aider à écrire une lettre pour dénigrer sa maîtresse, une Maure envers laquelle il s'est montré brutal ; il craint des représailles du frère de celle-ci. La semaine suivante, Raymond frappe et injurie sa maîtresse dans son appartement. La police intervient et convoque Raymond au commissariat. Celui-ci utilise Meursault comme témoin de moralité. En sortant, il l'invite, lui et Marie, à déjeuner le dimanche suivant à un cabanon au bord de la mer, qui appartient à un de ses amis, Masson. Lors de la journée, Marie demande à Meursault s'il veut se marier avec elle. Il répond que ça n'a pas d'importance, mais qu'il le veut bien. Le dimanche midi, après un repas bien arrosé, Meursault, Raymond et Masson se promènent sur la plage et croisent deux Arabes, dont le frère de la maîtresse de Raymond. Une bagarre éclate, au cours de laquelle Raymond est blessé au visage d'un coup de couteau. Plus tard, Meursault, seul sur la plage accablée de chaleur et de soleil, rencontre à nouveau l’un des Arabes, qui, à sa vue, sort un couteau. Aveuglé par la sueur, ébloui par le reflet du soleil sur la lame, Meursault tire de sa poche le revolver que Raymond lui a confié et tue l'Arabe d'une seule balle. Puis, sans raison apparente, il tire quatre autres coups sur le corps inerte.
Dans la seconde moitié du roman, Meursault est arrêté et questionné. Ses propos sincères et naïfs mettent son avocat mal à l'aise. Il ne manifeste aucun regret, mais de l'ennui. Lors du procès, on l'interroge davantage sur son comportement lors de l'enterrement de sa mère que sur le meurtre. Meursault se sent exclu du procès. Il dit avoir commis son acte à cause du soleil, ce qui déclenche l'hilarité de l'audience. La sentence tombe : il est condamné à la guillotine. L’aumônier visite Meursault pour qu'il se confie à Dieu dans ses derniers instants, Meursault refuse. Quand celui-ci lui dit qu'il priera pour lui, il déclenche sa colère. Avant son départ, Meursault finit par trouver la paix dans la sérénité de la nuit. |
L'auteur du roman
Albert Camus, né le 7 novembre 1913 en Algérie, et mort accidentellement le 4 janvier 1960.
C'est un écrivain, philosophe, romancier, dramaturge*, journaliste, essayiste* et nouvelliste français. Il est aussi journaliste militant engagé dans la Résistance française.
Son œuvre comprend des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des films, des poèmes et des essais dans lesquels il développe un humanisme* fondé sur la prise de conscience de l'absurde de la condition humaine mais aussi sur la révolte comme réponse à l'absurde, révolte qui conduit à l'action et donne un sens au monde et à l'existence : « alors naît la joie étrange qui aide à vivre et mourir »5.
Il reçoit le prix Nobel* de littérature en 1957.
Dans le journal Combat, ses prises de position sont audacieuses, aussi bien sur la question de l'indépendance de l'Algérie que sur ses rapports avec le Parti communiste français, qu'il quitte après un court passage de deux ans. Il ne se dérobe devant aucun combat, protestant successivement contre les inégalités qui frappent les musulmans d'Afrique du Nord, puis contre la caricature du pied-noir* exploiteur, ou prenant la défense des Espagnols exilés antifascistes, des victimes du stalinisme et des objecteurs de conscience.
En marge des courants philosophiques, Camus est d'abord témoin de son temps, intransigeant, refusant toute compromission. Il n'a cessé de lutter contre toutes les idéologies et les abstractions qui détournent de l'humain.
|
|
|
|
|
Humanisme : philosophie qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. (cf. Larousse)
Dramaturge : un dramaturge est un auteur de pièces de théâtre, la dramaturgie étant l’étude ou l’art de la composition théâtrale.
Essayiste : en littérature, un essai est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers et exposée de manière personnelle, voire subjective par l'auteur. Contrairement à l'étude, l'essai peut être polémique ou partisan. C'est un texte littéraire qui se prête bien à la réflexion philosophique, mais aussi à d'autres domaines : essais historiques, essais scientifiques, essais politiques.
Absurde : qui est contraire à la raison, au sens commun, qui est aberrant, insensé. (cf. Larousse). Chez Camus, c'est plus que cela en prenant une dimension philosophique. Voir ici.
Prix Nobel : à sa mort, le Suédois Alfred Nobel laisse un héritage de 32 millions de couronnes. Cette fortune vient de son invention : la dynamite. Dans son dernier testament, Alfred Nobel demande que soit créée une institution qui se chargera de récompenser chaque année des personnes qui auront rendu de grands services à l'humanité, permettant une amélioration ou un progrès considérable dans le domaine des savoirs et de la culture dans cinq disciplines différentes : paix ou diplomatie, littérature, chimie, physiologie ou médecine et physique. Le testament précise que la nationalité des savants primés ne doit jouer aucun rôle dans l'attribution du prix.
Pied-noir : relatif à la population d’origine européenne de l’Algérie coloniale. |
|
Un roman : pour quels objets d'étude ?
Identité et diversité |
En quoi le roman montre-t-il l'importance de la relation aux autres ? |
En quoi le roman montre-t-il qu'il a une grande nécessité à respecter les différences ? |
|
La parole en spectacle |
En quoi le passage du procès montre-t-il combien la parole publique peut être mise en scène ? |
En quoi le passage du procès montre-t-il les limites de cette "mise en scène" ? |
|
L'homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts |
En quoi le roman du XX° siècle achève-t-il la déconstruction du « héros » ? |
Aborder le roman par l'analyse de l'illustration de la couverture
Nicolas DE STAEL - Figures au bord de la mer, 1952 |
|||
Observer : de façon objective et ordonnée |
Interpréter : globalement et de façon cohérente |
||
Premier plan |
Couleurs |
mauve clair, bleu foncé, marron, noir, gris, brun... des couleurs froides. |
Deux personnages, un troisième au sol ? Une situation de face à face, inquiétante ? Un blessé au sol ? Un mort ?
|
Formes |
cubes, empilement, mi-cubes au sommet |
||
Postures |
Empilement vertical et au sol |
||
Deuxième plan |
Couleurs et formes |
Ocre uniforme. Précédé d'ocres plus foncés au "sol" (premier plan). |
Un désert ? Une mer ? L'ocre plus foncé étant le rivage, la plage ? |
Arrière plan |
Couleurs et formes |
Un brun foncé, trois formes ovales, quelques traits noirs les entourent partiellement. |
Le ciel ? Des nuages ? De sang ? Un bleu pour un espoir qui s'en va ? |
D'autres couvertures recoupent des choix d'illustration ou de mêmes éléments reviennent :
- plutôt un personnage, avec des couleurs froides, sans visage...
- des arrières-plans abstraits, troubles...
Activité 1
1 - Imaginer l'histoire de ce roman en allant jusqu'à la fin et en faisant en sorte que chaque élément imaginé corresponde à une observation précise de l'illustration, à indiquer entre parenthèses.
Une quinzaine de lignes.
Attention aux consignes habituelles.
2 - Accompagner ce récit d'une autre illustration de son choix, recherchée sur le web.
Justifier ce choix rapidement.
Quelques éléments de compréhension de la démarche de l'auteur
A) Contexte historique et littéraire
Dans les années 1930, le climat est difficile du fait de la crise économique, de tensions sociales et politiques liées à la montée des fascismes.
Ce climat a des conséquences sur le genre du roman : le genre romanesque subit de profondes mutations. Les romanciers cherchent à explorer la psychologie humaine, le moi, dans leurs romans, et s’interrogent sur le monde ; ils réfléchissent à la condition humaine, en essayant de répondre notamment aux questions : « pourquoi vit-on ? comment doit-on vivre ? quel sens donner à la vie humaine ? »
Camus lui-même choisit le genre du roman et le personnage de Meursault pour mener des réflexions philosophiques et pour porter un regard critique sur la société contemporaine : « Si tu veux être philosophe, écris des romans ».
B) La philosophie du roman : L’ABSURDE et LA REVOLTE
Le Mythe de Sisyphe* : l’absurde naît de « cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde ».
Selon Camus, l’existence est absurde, c’est-à-dire qu’elle est privée de sens, car les événements ne sont pas dus à Dieu (qui n’existe pas) mais au hasard. Or, le monde inspire à l’homme une volonté de le comprendre, une soif d’absolu, qu’il ne peut pas combler, étant donné que rien ne permet de comprendre l’univers, et que l’homme est voué inévitablement à la mort.
Cf ses Carnets (1937) : « Le type qui donnait toutes les promesses et qui travaille maintenant dans un bureau. Il ne fait rien d’autre part, rentrant chez lui, se couchant et attendant l’heure du dîner en fumant, se couchant à nouveau et dormant jusqu’au lendemain. Le dimanche, il se lève très tard et se met à sa fenêtre, regardant la pluie ou le soleil, les passants ou le silence. Ainsi toute l’année. Il attend. Il attend de mourir. A quoi bon les promesses, puisque de toute façon… »
L’homme doit-il donc s’abandonner au désespoir ?
Selon Camus, non, et c’est ce qui constitue la « leçon » de L’Etranger : à l’image du héros Meursault, l’homme, une fois qu’il a pris conscience que le monde est absurde, ne doit pas se résigner, mais au contraire se révolter : il doit crier son amour pour la vie et affronter courageusement l’épreuve de la mort.
La grandeur de l’homme consiste à assumer l’absurdité du monde.
* Désigne deux "choses" :
- dans la mythologie grecque : les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu'au sommet d'une montagne d'où la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé avec quelque raison qu'il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir.
- c'est aussi le titre d'un autre livre d'Albert Camus, écrit à la même période et qu'il aurait voulu voir publier en même temps. Ce livre est un essai philosophique.
Analyse de l'incipit* (extrait n°1)
* : l'incipit désigne le début d'un roman, de longueur variable. Il peut ne durer que quelques phrases, mais peut aussi concerner plusieurs pages. Le [c] se prononce [inkipit] ou [insipit].
L'incipit a plusieurs fonctions : annoncer et préparer la suite du récit (définition du genre, narration, etc.) / attirer la curiosité du lecteur et donc intéresser ce dernier (intrigue par exemple) / informer le lecteur sur les principales informations du récit (personnage(s), lieu(x), temps, etc.) / installer le lecteur dans le cadre, le contexte (arrivée soudaine ou progressive d'un événement par exemple).
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile : « Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués. » Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier.
L'asile de vieillards est à Marengo, à quatre-vingts kilomètres d'Alger. Je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit : « Ce n'est pas de ma faute. » Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle.
J'ai pris l'autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit : « On n'a qu'une mère. » Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle, il y a quelques mois.
J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute, ajouté aux cahots, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit « oui » pour n'avoir plus à parler.
L'asile est à deux kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite, j'ai vu le directeur : il m'a reçu dans son bureau. C'était un petit vieux, avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs. Puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit : « Mme Meursault est entrée ici il y a trois ans. Vous étiez son seul soutien. » J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer. Mais il m'a interrompu : « Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes. Et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. » J'ai dit : « Oui, monsieur le Directeur. » Il a ajouté : « Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. »
C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent. Mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile. Toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que dans la dernière année je n'y suis presque plus allé. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche - sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire deux heures de route.
Albert CAMUS, L’Etranger, I, 1, 1942
Activité 2
En quoi les outils littéraires choisis par Camus lui permettent-ils de nous faire ressentir le profil psychologique particulier de son personnage principal, Meursault ?
Outils littéraires |
« Preuves » relevées |
Intentions de l'auteur |
Le pronom personnel, le choix du narrateur |
« Je » |
En tant que lecteur, nous sommes Meursault. Nous sommes donc le mieux placé pour constater le caractère très particulier de toutes ses émotions même les moins visibles. |
Le narrateur est présent. Il est le personnage principal. Il sera le seul narrateur, tout le long du roman. |
||
|
Description physique et portrait moral (caractère) |
Aucune description physique et morale des personnages. |
L'absence de précisions rend ainsi tous les personnages plus impersonnels, sans identité plus marquée, réduits à leur fonction dans la société. Sans autre affect. |
Juste des prénoms : « Céleste » des fonctions : « maman », « le directeur de l’asile », « le patron », « le concierge ». On connaît juste le nom du personnage principal, même pas son prénom. Le personnage tué n'aura également pas de nom. |
||
|
Le cadre spatio-temporel |
Les lieux : très peu d'indications. « Alger », « à deux heures de route de l’asile de Marengo » |
On reste dans une confusion, sans trop savoir à quelle époque exactement on se situe. Une situation où l'on ne reste sûr de rien. |
Le temps : une chronologie en tous sens. « aujourd'hui », « demain », « hier », « deux jours de congé » |
||
|
Le niveau de langue |
Un vocabulaire courant, simple. |
Les mots ne nous amènent pas de réponses. La plupart ne restent que des observations externes. On n'est pas invité à rentrer dans la profondeur d'une explication plus poussée, un vocabulaire plus subtil. |
|
La syntaxe |
Des phrases plutôt courtes. Voire des phrases curieusement coupées : « Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. » |
La syntaxe coupe le sens en morceaux de réalité sans cohérence. |
|
Figures de style (images poétiques) |
Aucune dans ce passage. |
Pas de recul sur la réalité. |
|
Champs lexicaux |
Champ lexical du temps :
« Aujourd'hui », « hier » (x2), « demain » (x2), « deux heures » (x3), « l'après-midi », « soir », « après-demain », « moment », « après », « habitude » (x3), « pendant » (x2), « tout de suite », « attendu », « temps » (x3), « ensuite », « ans », « jours », « mois », « souvent », « année »
Des expressions du doute :
« sais pas », « peut-être » (x2), « rien dire », « je n'aurais pas du », « il n'avait pas l'air », « sans doute », « un peu comme si », « je ne savais trop », « j'ai cu que » |
Meursault est hors du temps. Il est donc entouré d'un monde qui bouge, en tous sens, mais sans lui.
Meursault n'est sûr de rien, ni de la réalité et des réactions des gens qui l'entourent, ni de lui-même. |
|
Le texte descriptif |
Très peu de description : « l'autobus à deux heures », « à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel », « une cravate noire et un brassard ». |
Meursault ne perçoit que des détails annexes et qui sont sans rapport avec les émotions qui devraient l'habiter (tristesse). |
|
La ponctuation |
Dans ces phrases : « Ou peut-être hier, je ne sais pas. » et « C'était peut-être hier. », on s'attend à un point d'interrogation. |
Meursault se pose des questions. Mais ne se les pose pas. L'absence de point d'interrogation nous plonge dans cette indifférence de Meursault. |
|
Les paroles rapportées |
« Ce n'est pas ma faute. », « On n'a qu'une mère ». « Oui » |
Les paroles rapportées viennent toujours souligner la déconnection entre Meursault et la réalité. |
|
1
5
10
15
20
25
30
|
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile : « Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués. » Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à quatre-vingts kilomètres d'Alger. Je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit : « Ce n'est pas de ma faute. » Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit : « On n'a qu'une mère. » Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle, il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute, ajouté aux cahots, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit « oui » pour n'avoir plus à parler. L'asile est à deux kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite, j'ai vu le directeur : il m'a reçu dans son bureau. C'était un petit vieux, avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs. Puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit : « Mme Meursault est entrée ici il y a trois ans. Vous étiez son seul soutien. » J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer. Mais il m'a interrompu : « Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes. Et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. » J'ai dit : « Oui, monsieur le Directeur. » Il a ajouté : « Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. » C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent. Mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile. Toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que dans la dernière année je n'y suis presque plus allé. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche - sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire deux heures de route.
Albert CAMUS, L’Etranger, I, 1, 1942
|
Au final, Camus utilise bien une multitude d'outils, tout le long de cet incipit, pour nous amener à ressentir tout le trouble qui règne sur les attitudes, les réactions, les pensées et les sentiments de Meursault.
Un Meursault qui ne comprend pas le monde, ne cherche pas à le comprendre de la même façon que le reste de la société. Normalement, il devrait être triste. Rien de ce premier extrait n'en témoigne.
Rédiger deux paragraphes méthodiques en exploitant deux lignes de ce tableau.
Mots de la question
Réponse (reformulation = vocabulaire personnel)
Connecteur logique
Preuves (citations courtes, entre « guillemets")
Activité 3
Objet d'étude : Identité et Diversité
Qu'est ce qui, dans ce premier paragraphe, montre toute la supposée absurdité des réactions de Meursault ? (absurdité dans le sens où cela ne correspond pas à la vision qu'on se fait de cette situation). Rédiger un paragraphe méthodique.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile : « Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués. » Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier.
Ce qui, dans ce premier paragraphe, montre toute la supposée absurdité des réactions de Meursault, c'est le jeu de l'écrivain avec nos propres réactions. En effet, lorsque Camus écrit « cela ne veut rien dire », le lecteur comprend qu'adresser des « sentiments distingués » à quelqu'un qui vient de perdre sa maman n'est pas adapté à la situation, cela ne veut rien dire. On s'attend plus à des « condoléances » ou des « pensées amicales ». Le lecteur peut donc être un temps en phase avec Meursault qui serait choqué par cette « inconvenance », cette maladresse de savoir vivre (en société) de la part de ce directeur. Mais, et c'est là où Camus joue avec nos propres conventions de la vie en société, la phrase qui suit : « C'était peut-être hier » nous surprend pleinement en nous donnant tort dans l'interprétation conventionnelle qu'on vient de faire. Meursault n'éprouve pas de tristesse mais simplement un doute pour un fait dénué de toute compassion de sa part : une incertitude sur la date ! Il s'interroge simplement sur la date. Rien d'autre ne semble le préoccuper, même pas la mort de sa propre mère ? De même, on retrouve ce « jeu » de l'écrivain quand Meursault semble enfin se confier sur une réaction émotive : « J'étais un peu étourdi ». Mais non, une fois encore, c'est simplement parce que Meursault doit monter « chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard.
Approfondissements
Si l'on suit Camus, il ne faut donc pas en conclure que Meursault n'éprouve aucun sentiment. Non. Les réactions de Meursault, ici, ne correspond simplement pas aux conventions sociales : si l'on perd sa mère, on doit manifester de la tristesse.
Meursault, ici, rend compte de la philosophie de Camus, le monde est absurde (cf. la vie qui ne peut qu'aboutir à la mort), il n'y a donc aucune nécessité à chercher à le comprendre et à s'en attrister.
Activité 4
Vous êtes enquêteur.
Dans un tableau, première colonne, relevez tous les éléments qui nous présentent Meursault comme « coupable » d'indifférence pour la mort de sa mère.
Puis, seconde colonne, relevez tous les éléments qui pourraient être « à décharge » pour Meursault et sa supposée indifférence.
|
Éléments à charge |
Éléments à décharge |
|
|
- ne semble faire attention qu'aux détails pratiques induits par cette annonce : « je prendrai l'autobus demain », « il me verra en deuil »
- ne cherche pas à en savoir plus sur la mort de sa mère : « ou peut-être hier. », « comme si maman n'était pas morte »
- semble se servir de la mort de sa mère : « une excuse pareille », « oui monsieur le Directeur », « C'était vrai »
- semble témoigner de sa propre indifférence : « ce n'est pas ma faute », « une allure plus officielle », « ils avaient tous beaucoup de peine pour moi », « je me suis assoupi », « j'ai dormi », « j'ai cru qu'il me reprochait quelque chose », « j'ai commencé à lui expliquer », « je n'y suis presque plus allé »
- sa seule gêne vient d'autre chose que de la tristesse attendue : « Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute, ajouté aux cahots, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel », - semble presser d'en finir : « je rentrerai demain », « ce sera une affaire classée »
- se trouve des excuses sordides : « cela me prenait mon dimanche - sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire deux heures de route », « elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile. » |
- des réactions qui témoignent d'une certaine peine ? « j'ai voulu voir maman tout de suite », « pour n'avoir plus à parler »
- un fils attentionné : « Vous étiez son seul soutien »
- pas responsable de « l'abandon » de sa mère : « Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes. Et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. », « elle devait s'ennuyer avec vous. »
|
Vous êtes procureur.
Rédiger deux paragraphes méthodiques pour accuser Meursault, au nom de la défense de la « société ».
Vous êtes avocat.
Rédiger deux paragraphes méthodiques pour défendre Meursault, au nom du droit à la différence.
Analyse du passage du meurtre (extrait n°2)
Avant cet extrait, Meursault a décidé de retourner se promener seul sur la plage, avec le pistolet de Raymond, mais sans intention de tuer « l’Arabe »(meurtre non prémédité).
Cette scène du meurtre est située à un endroit-clé du roman : avant la deuxième partie, pour montrer qu’à partir de ce moment, la vie de Meursault bascule de manière tragique.
|
1
5
10
15
|
J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. L'Arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman et, comme alors, le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'Arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jailli du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé, j'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur.
Albert CAMUS, L’Etranger, I, 6, 1942
|
Activité 5
Objet d'étude : L'homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts.
Comment Camus s'y prend-t-il pour montrer que Meursault ne maîtrise rien de ce monde absurde qui l'entoure ?
|
1
5
10
15
|
J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. L'Arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman et, comme alors, le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'Arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jailli du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé, j'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur.
|
Albert CAMUS, L’Etranger, I, 6, 1942
Procédés littéraires |
« Preuves » relevées (citations du texte) |
Intentions de l'auteur (réponses à la question) |
Répétition volontaire d'un même mot |
« Soleil » x 7 |
Il y a un autre « responsable » que Meursault, le soleil. Et ce « coupable » est là depuis le début (cf. extrait 1 : « il faisait très chaud » l.10). Il était déjà là dans le nom même du personnage : « Mort » + « Soleil » = Meursault |
Champ lexical : des forces naturelles agissantes, presque personnifiées. |
Un « soleil » qui fait du bruit, une « plage » qui « pousse », la « mer » qui « souffle », le « ciel » qui « s'ouvre », le « feu » |
Toutes les forces de la nature, du monde, s'allient pour prendre le contrôle de la situation. Meursault ne fait que subir ces forces incontrolables. |
Champ lexical : quasiment tous les sens saturés, hors de contrôle |
« Vibrante », « cymbales », « bruit », « assourdissant », « silence » (ouïe), « ombre » « lumière », « rideau », « voile », « aveuglés », « étincelante », « yeux » (x2) (vue), « brûlure » (x2), « brûlante » (x2), « senti », « sentais », « touché », « tiède » (toucher), « sel » (goût). « Tout mon être s'est tendu ». |
Meursault ne perçoit plus le monde « normal », tous ses sens sont agressés. Il est bien « étranger » à ce monde agressif sans raison. |
Champ lexical : de la douleur, de la violence |
« amasser » (x2), « mal », « battaient », « supporter », « tiré », « couteau », « giclé », « acier », « lame », « atteignait », « sueur » (x 2), « larmes », « glaive », « couteau », « épée », « rongeait », « douloureux », « vacillé », « charrié », « feu », « crispé », « revolver », « gâchette », « cédé », « crosse », « secoué », « tiré », « inerte », « balles », « s'enfonçaient », « coups », « malheur » |
C'est sous l'effet de multiples douleurs, de multiples agressions, finalement, que Meursault doit se défendre, ne fait que répondre par instinct à un danger qui le menace. Il est d'abord une victime et c'est l'arme qui agit presque seule (cf. toutes les pièces du revolver sont agissantes). |
Analyse du passage du procès (extrait n°3)
|
1
5
10
15
20
25
30
|
L'après-midi, les grands ventilateurs brassaient toujours l'air épais de la salle et les petits éventails multicolores des jurés s'agitaient tous dans le même sens. La plaidoirie de mon avocat me semblait ne devoir jamais finir. À un moment donné, cependant, je l'ai écouté parce qu'il disait : « Il est vrai que j'ai tué. » Puis il a continué sur ce ton, disant « je » chaque fois qu'il parlait de moi. J'étais très étonné. Je me suis penché vers un gendarme et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit de me taire et, après un moment, il a ajouté : « Tous les avocats font ça. » Moi, j'ai pensé que c'était m'écarter encore de l'affaire, me réduire à zéro et, en un certain sens, se substituer à moi. Mais je crois que j'étais déjà très loin de cette salle d'audience. D'ailleurs, mon avocat m'a semble ridicule. Il a plaidé la provocation très rapidement et puis lui aussi a parlé de mon âme. Mais il m'a paru qu'il avait beaucoup moins de talent que le procureur. « Moi aussi, a-t-il dit, je me suis penché sur cette âme, mais, contrairement à l'éminent représentant du ministère public, j'ai trouvé quelque chose et je puis dire que j'y ai lu a livre ouvert. » Il y avait lu que j'étais un honnête homme, un travailleur régulier, infatigable, fidèle à la maison qui l'employait, aimé de tous et compatissant aux misères d'autrui. Pour lui, j'étais un fils modèle qui avait soutenu sa mère aussi longtemps qu'il l'avait pu. Finalement j'avais espéré qu'une maison de retraite donnerait à la vieille femme le confort que mes moyens ne me permettaient pas de lui procurer. « Je m'étonne, Messieurs, a-t-il ajouté, qu'on ait mené si grand bruit autour de cet asile. Car enfin, s'il fallait donner une preuve de l'utilité et de la grandeur de ces institutions, il faudrait bien dire que c'est l'État lui-même qui les] subventionne. » Seulement, il n'a pas parlé de l'enterrement et j'ai senti que cela manquait dans sa plaidoirie. Mais à cause de toutes ces longues phrases, de toutes ces journées et ces heures interminables pendant lesquelles on avait parlé de mon âme, j'ai eu l'impression que tout devenait comme une eau incolore où je trouvais le vertige. À la fin, je me souviens seulement que, de la rue et à travers tout l'espace des salles et des prétoires, pendant que mon avocat continuait à parler, la trompette d'un marchand de glace a résonné jusqu'à moi. J'ai été assailli des souvenirs d'une vie qui ne m'appartenait plus, mais où j'avais trouvé les plus pauvres et les plus tenaces de mes joies : des odeurs d'été, le quartier que j'aimais, un certain ciel du soir, le rire et les robes de Marie. Tout ce que je faisais d'inutile en ce lieu m'est alors remonté à la gorge et je n'ai eu qu'une hâte, c'est qu'on en finisse et que je retrouve ma cellule avec le sommeil. C'est à peine si j'ai entendu mon avocat s'écrier, pour finir, que les jurés ne voudraient pas envoyer à la mort un travailleur honnête perdu par une minute d'égarement et demander les circonstances atténuantes pour un crime dont je traînais déjà, comme le plus sûr de mes châtiments, le remords éternel. La cour a suspendu l'audience et l'avocat s'est assis d'un air épuisé. Mais ses collègues sont venus vers lui pour lui serrer la main. J'ai entendu : « Magnifique, mon cher. » L'un d'eux m'a même pris à témoin : « Hein ? » m'a-t-il dit. J'ai acquiescé, mais mon compliment n'était pas sincère, parce que j'étais trop fatigué.
Albert CAMUS, L’Etranger, II, 4, 1942
|
Activité 6
Objet d'étude : La parole en spectacle
1 - Comment Camus s'y prend-t-il pour montrer que ce procès est un « spectacle » dont tous sont volontairement dupes ?
|
1
5
10
15
20
25
30
|
L'après-midi, les grands ventilateurs brassaient toujours l'air épais de la salle et les petits éventails multicolores des jurés s'agitaient tous dans le même sens. La plaidoirie de mon avocat me semblait ne devoir jamais finir. À un moment donné, cependant, je l'ai écouté parce qu'il disait : « Il est vrai que j'ai tué. » Puis il a continué sur ce ton, disant « je » chaque fois qu'il parlait de moi. J'étais très étonné. Je me suis penché vers un gendarme et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit de me taire et, après un moment, il a ajouté : « Tous les avocats font ça. » Moi, j'ai pensé que c'était m'écarter encore de l'affaire, me réduire à zéro et, en un certain sens, se substituer à moi. Mais je crois que j'étais déjà très loin de cette salle d'audience. D'ailleurs, mon avocat m'a semblé ridicule. Il a plaidé la provocation très rapidement et puis lui aussi a parlé de mon âme. Mais il m'a paru qu'il avait beaucoup moins de talent que le procureur. « Moi aussi, a-t-il dit, je me suis penché sur cette âme, mais, contrairement à l'éminent représentant du ministère public, j'ai trouvé quelque chose et je puis dire que j'y ai lu à livre ouvert. » Il y avait lu que j'étais un honnête homme, un travailleur régulier, infatigable, fidèle à la maison qui l'employait, aimé de tous et compatissant aux misères d'autrui. Pour lui, j'étais un fils modèle qui avait soutenu sa mère aussi longtemps qu'il l'avait pu. Finalement j'avais espéré qu'une maison de retraite donnerait à la vieille femme le confort que mes moyens ne me permettaient pas de lui procurer. « Je m'étonne, Messieurs, a-t-il ajouté, qu'on ait mené si grand bruit autour de cet asile. Car enfin, s'il fallait donner une preuve de l'utilité et de la grandeur de ces institutions, il faudrait bien dire que c'est l'État lui-même qui les] subventionne. » Seulement, il n'a pas parlé de l'enterrement et j'ai senti que cela manquait dans sa plaidoirie. Mais à cause de toutes ces longues phrases, de toutes ces journées et ces heures interminables pendant lesquelles on avait parlé de mon âme, j'ai eu l'impression que tout devenait comme une eau incolore où je trouvais le vertige. À la fin, je me souviens seulement que, de la rue et à travers tout l'espace des salles et des prétoires, pendant que mon avocat continuait à parler, la trompette d'un marchand de glace a résonné jusqu'à moi. J'ai été assailli des souvenirs d'une vie qui ne m'appartenait plus, mais où j'avais trouvé les plus pauvres et les plus tenaces de mes joies : des odeurs d'été, le quartier que j'aimais, un certain ciel du soir, le rire et les robes de Marie. Tout ce que je faisais d'inutile en ce lieu m'est alors remonté à la gorge et je n'ai eu qu'une hâte, c'est qu'on en finisse et que je retrouve ma cellule avec le sommeil. C'est à peine si j'ai entendu mon avocat s'écrier, pour finir, que les jurés ne voudraient pas envoyer à la mort un travailleur honnête perdu par une minute d'égarement et demander les circonstances atténuantes pour un crime dont je traînais déjà, comme le plus sûr de mes châtiments, le remords éternel. La cour a suspendu l'audience et l'avocat s'est assis d'un air épuisé. Mais ses collègues sont venus vers lui pour lui serrer la main. J'ai entendu : « Magnifique, mon cher. » L'un d'eux m'a même pris à témoin : « Hein ? » m'a-t-il dit. J'ai acquiescé, mais mon compliment n'était pas sincère, parce que j'étais trop fatigué.
Albert CAMUS, L’Etranger, II, 4, 1942
|
Intentions de l'auteur (réponses à la question) |
« Preuves » relevées (citations du texte) |
Procédés littéraires |
Un avocat comédien qui joue le rôle de Meursault en parlant à sa première personne « je ». |
« Il est vrai que j'ai tué. » « Tous les avocats font ça. » |
Les paroles rapportées : discours direct et indirect |
Un avocat qui en fait trop, qui surjoue. |
« infatigable », « aimé de tous », « fils modèle », « dont je traînais déjà, comme le plus sûr des châtiments, le remords éternel », « âme » |
Hyperboles |
Un avocat qui décrit maladroitement Meursault. |
« infatigable », « aimé de tous », « fils modèle », « dont je traînais déjà, comme le plus sûr des châtiments, le remords éternel » |
Hyperboles |
Un avocat qui dresse un portrait type, un portrait stérérotypé qui ne colle pas à Meursault |
« infatigable », « aimé de tous », « fils modèle », « dont je traînais déjà, comme le plus sûr des châtiments, le remords éternel » |
Hyperboles |
Même si ce procès est bien réel pour Meursault, pour l'avocat, pour l'opinion public, tout cela est au final une "histoire", un "récit", presque comme l'égal d'une "fiction", "un livre"... |
« à livre ouvert » |
Une métaphore |
Même si ce procès est bien réel pour Meursault, pour l'avocat, pour l'opinion public, tout cela est au final une "histoire", un "récit", presque comme l'égal d'une "fiction", "un livre"... |
« Magnifique mon cher ! »
« un air épuisé » |
Hyperbole |
Objet d'étude : Identité et diversité
2 - Comment Camus s'y prend-t-il pour montrer que ce procès est aussi un « spectacle » dont Meursault refuse de jouer le jeu ?
Intentions de l'auteur (réponses à la question) |
« Preuves » relevées (citations du texte) |
Procédés littéraires |
Meursault ne comprend pas ce « jeu ». |
« J'étais très étonné » |
Focalisation interne |
Un avocat comédien qui joue le rôle de Meursault en parlant à sa première personne « je ». |
« Il est vrai que j'ai tué. » « Tous les avocats font ça. » |
Les paroles rapportées : discours direct et indirect |
Meursault refuse de se prêter à ce jeu, cette "représentation". |
« mon compliment n'était pas sincère » |
Focalisation interne |
Meursault dénonce même la fausseté de la situation et des attitudes de son avocat. |
« mon avocat m'a paru ridicule » « beaucoup moins de talent que le procureur »
« grands ventilateurs » / « petits éventails » |
Focalisation interne
Comparaison
Antithèse |
Meursault dénonce même un procès qui est déjà joué, seule la mise en scène restant. |
« les petits éventails multicolores des jurés s'agitaient tous dans le même sens » |
Un exercice type bac
Activité 7
Sujet (modifié) de la session 2015 / BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL / Toutes spécialités
ÉPREUVE DE FRANÇAIS
Pour info : Coefficient : 2,5 Durée : 2h30
Document 1
Meursault, le personnage central de L’étranger est un homme qui semble dépourvu de sentiments face aux événements qu’il vit. Il a tué un homme sur une plage d’Alger. Son procès commence.
|
1
5
10
15
20
25
30
35
40
|
À sept heures et demie du matin, on est venu me chercher et la voiture cellulaire m’a conduit au palais de justice. Les deux gendarmes m’ont fait entrer dans une petite pièce qui sentait l’ombre. Nous avons attendu, assis près d’une porte derrière laquelle on entendait des voix, des appels, des bruits de chaises et tout un remue-ménage qui m’a fait penser à ces fêtes de quartier où, après le concert, on range la salle pour pouvoir danser. Les gendarmes m’ont dit qu’il fallait attendre la cour et l’un d’eux m’a offert une cigarette que j’ai refusée. Il m’a demandé peu après « si j’avais le trac ». J’ai répondu que non. Et même, dans un sens, cela m’intéressait de voir un procès. Je n’en avais jamais eu l’occasion dans ma vie : « Oui, a dit le second gendarme, mais cela finit par fatiguer. » Après un peu de temps, une petite sonnerie a résonné dans la pièce. Ils m’ont alors ôté les menottes. Ils ont ouvert la porte et m’ont fait entrer dans le box des accusés. La salle était pleine à craquer. Malgré les stores, le soleil s’infiltrait par endroits et l’air était déjà étouffant. On avait laissé les vitres closes. Je me suis assis et les gendarmes m’ont encadré. C’est à ce moment que j’ai aperçu une rangée de visages devant moi. Tous me regardaient : j’ai compris que c’étaient les jurés. Mais je ne peux pas dire ce qui les distinguait les uns des autres. Je n’ai eu qu’une impression : j’étais devant une banquette de tramway et tous ces voyageurs anonymes épiaient le nouvel arrivant pour en apercevoir les ridicules. Je sais bien que c’était une idée niaise puisque ici ce n’était pas le ridicule qu’ils cherchaient, mais le crime. Cependant la différence n’est pas grande et c’est en tout cas l’idée qui m’est venue. J’étais un peu étourdi aussi par tout ce monde dans cette salle close. J’ai regardé encore le prétoire et je n’ai distingué aucun visage. Je crois bien que d’abord je ne m’étais pas rendu compte que tout le monde se pressait pour me voir. D’habitude, les gens ne s’occupaient pas de ma personne. Il m’a fallu un effort pour comprendre que j’étais la cause de toute cette agitation. J’ai dit au gendarme : « Que de monde ! » Il m’a répondu que c’était à cause des journaux et il m’a montré un groupe qui se tenait près d’une table sous le banc des jurés. Il m’a dit : « Les voilà. » J’ai demandé : « Qui ? » et il a répété : « Les journaux. » Il connaissait l’un des journalistes qui l’a vu à ce moment et qui s’est dirigé vers nous. C’était un homme déjà âgé, sympathique, avec un visage un peu grimaçant. Il a serré la main du gendarme avec beaucoup de chaleur. J’ai remarqué à ce moment que tout le monde se rencontrait, s’interpellait et conversait, comme dans un club où l’on est heureux de se retrouver entre gens du même monde. Je me suis expliqué aussi la bizarre impression que j’avais d’être de trop, un peu comme un intrus. Pourtant, le journaliste s’est adressé à moi en souriant. Il m’a dit qu’il espérait que tout irait bien pour moi. Je l’ai remercié et il a ajouté : « Vous savez, nous avons monté un peu votre affaire. L’été, c’est la saison creuse pour les journaux. Et il n’y avait que votre histoire et celle du parricide1 qui vaillent quelque chose. » (…) Mon avocat est arrivé, en robe, entouré de beaucoup d’autres confrères. Il est allé vers les journalistes, a serré des mains. Ils ont plaisanté, ri et ils avaient l’air tout à fait à leur aise, jusqu’au moment où la sonnerie a retenti dans le prétoire. Tout le monde a regagné sa place. Mon avocat est venu vers moi, m’a serré la main et m’a conseillé de répondre brièvement aux questions qu’on me poserait, de ne pas prendre d’initiatives et de me reposer sur lui pour le reste. À ma gauche, j’ai entendu le bruit d’une chaise qu’on reculait et j‘ai vu un grand homme mince, vêtu de rouge, portant lorgnon, qui s’asseyait en pliant sa robe avec soin. C’était le procureur. Un huissier a annoncé la cour. Au même moment, deux gros ventilateurs ont commencé de vrombir. Trois juges, deux en noir, le troisième en rouge, sont entrés avec des dossiers et ont marché très vite vers la tribune qui dominait la salle. L’homme en robe rouge s’est assis sur le fauteuil du milieu, a posé sa toque devant lui, essuyé son petit crâne chauve avec un mouchoir et déclaré que l’audience était ouverte.
Albert CAMUS, L’étranger (1957) |
1 : Meurtre d’un père ou d’une mère par l’un de ses enfants.
Évaluation des compétences de lecture (10 points)
Présentation du corpus
Question n°1 : Présentez le corpus en trois à six lignes en montrant ce qui fonde son unité. (3 points)
Analyse et interprétation
Question n°2 : Document 1.
Comment l’extrait montre-t-il que Meursault observe son propre procès comme un spectacle ? (3 points)
Question n°3 : Documents 1 et 2.
En quoi le document 2 illustre-t-il cette comparaison avec un spectacle ? En quoi le document 2 ne se résume pas à cette dimension ? (4 points)
Évaluation des compétences d’écriture (10 points)
Selon vous, pourquoi rendre la justice nécessite-t-il une certaine « mise en scène » ?
Vous répondrez à cette question, dans un développement organisé d’une vingtaine de lignes, en vous appuyant sur vos connaissances personnelles, vos lectures, d’autres oeuvres.
Présentation de l'oeuvre à "l'épreuve orale de contrôle"
Qu'est ce que "l'oral de contrôle" ?
Un candidat qui obtient entre 8 et 9.99 sur 20 n'obtient pas le baccalauréat au premier tour mais est convoqué* pour un "rattrapage", une seconde chance d'obtenir le baccalauréat.
*(convocation sur Abbeville, Amiens, etc... en fonction des spécialités).
Ce jour là, le candidat devra passer deux oraux, l'un à la suite de l'autre :
1 - l'un portant sur les mathématiques ou l'enseignement professionnel (c'est le Rectorat qui détermine ce choix).
2 - l'autre portant sur le français ou l'histoire géographie.
En français/histoire-géographie, sur place, le candidat tirera au sort entre 12 sujets : 6 sujets de français (en fait six fois le même, voir ci-dessous) mélangés avec 3 sujets d'histoire et 3 sujets de géographie.
Il y a donc toujours, pour chaque candidat, 12 sujets disponibles.
Une chance sur deux de tomber sur le sujet de français.
C'est la moyenne de ces deux oraux qui, ajoutée à la note obtenue par le candidat au premier tour, détermine si oui ou non le candidat obtient le baccaulauréat.
Les textes réglementant cette "épreuve orale de contrôle" :
Extrait du Bulletin officiel n°18 du 6 mai 2010 définissant "l'Épreuve orale de contrôle".
Les modalités de l'épreuve orale de contrôle.
Grille de notation de la partie Français/Histoire Géographie de l'oral de contrôle.
(cadeau : grille de notation de la partie Mathématiques-Sciences/Enseignement professionel).
Qu'attend-t-on du candidat s'il tire un sujet en français ?
Le libellé du sujet est toujours le même :
« Après avoir présenté une œuvre intégrale/un groupement de textes le plus préciséme nt possible (titre(s) d'œuvre(s), auteur(s), époque(s) de publication, pr opos de l'œuvre/des textes), vous expliquerez ce qui vous a intéressé d ans cette étude dont vous présenterez les principales lignes de force. ».
Que dire sur l'étude de l'oeuvre intégrale : L'Étranger, d'Albert Camus ?
1 - Titre de l'oeuvre, nom de l'auteur, quelques éléments biographiques.
2 - Les objets d'étude qui ont été explorés avec le travail effectué sur cette oeuvre intégrale.
3 - Les réponses qui résultent de ce travail sur les trois objets d'étude.
I - Identité et diversité
Notre identité se forge au contact des autres, de nos modes de vie, de l'endroit du monde où l'on vit, etc...
La société a parfois du mal à accepter les différences, le fait qu'un individu se comporte différemment du reste de la société.
Meursault reste bien cet "étranger" à la société dans laquelle il vit. Finalement, c'est la principale raison pour laquelle cette même société le condamne à mort. Etait-ce une raison suffisante ?
II - La parole en spectacle
Prendre la parole devant un public, fut-il restreint, est toujours un acte codifié par des conventions sociales.
Ne pas respecter cela, c'est prendre le risque d'être incompris, voire rejeté.
Ne pas lidentifier cela, c'est aussi prendre le risque d'en être dupe, de se faire manipuler.
Etre capable de dresser les caractéristiques de ces situations, c'est être capable de mieux communiquer, mieux se faire comprendre, voire dénoncer d'autres aspects plus manipulatoires.
Quand Camus décrit le procès de Meursault, il dénonce bien ce spectacle de la parole en public.
III - L'homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts.
L'art témoigne toujours de l'état d'esprit d'une époque, d'une société. S'intéresser à l'art, c'est être le témoin privilégié de traces du passé qui ne sont pas autrement transmissibles. Que saurions-nous des hommes préhistoriques, leur conception du bonheur, de l'au-delà, etc... si nous n'avions pas leurs témoignages artistiques.
Quand Camus dénonce l'absurdité du monde, l'Europe est, pour la seconde fois, dans une guerre mondiale qui reste la tragédie la plus marquante pour nos sociétés. Même si Camus n'a pas de démarche politique dans son roman, ce contexte reste aussi disponible à la réflexion pour relire ce roman.
4 - Etre capable de dire quel(s) intérêt(s) le candidat a trouvé dans ce travail d'analyse.
Par exemples :
- Le professeur était excellent (très bon ça).
- Cela m'a permis de m'interroger sur mes propres expériences dans ces domaines (accepter les différences, s'interroger sur les comportements en société, m'interroger sur ma propre aptitude à accepter les différences, etc...)
- Comprendre qu'un bon écrivain ne travaille jamais sans intention, sans une maîtrise claire des effets produits par les outils qu'il choisit d'utiliser. Ecrire, c'est toujours avoir une intention.
- La dimension philosophique du récit est une bonne façon d'aborder des questions fondamentales auxquelles il m'appartient de les explorer.
Etc...
5 - Etre capable de dialoguer avec l'examinateur, en s'exprimant de façon à démonter des compétences de communication.
- Je parle suffisamment fort, avec un rythme que je veille à ralentir (histoire que mes pensées passent d'abord par mon cerveau, y fasse un petit tour pour ensuite être exprimées à l'oral).
- Sans fixer des yeux l'examinateur, je n'oublie pas de renouer le contact visuel régulièrement. On communique essentiellement avec les yeux.
- Mes mains sont sur la table avec un crayon (je ne joue pas avec) ou avec mes feuilles. Les coudes posés sur la table, me stabilise et m'évite d'être soit affalé sur la chaise, soit trop penché sur ma feuille.
- J'évite les tenues trop ostentatoires (ha les fameuses conventions sociales)...
- J'essaie de terminer mes phrases, en évitant toutes les abréviations, le langage familier, les onomatopées (ben euh...).
- Un sourire n'est jamais perdu. Il témoigne aussi d'une curiosité à l'autre.
- Je me montre "combattif", curieux...
Bon bref...
La notation porte essentillement sur l'aptitude du candidat à s'exprimer à l'oral. Voir la grille d'évaluation !
Il n'y a donc pas lieu d'apprendre par coeur, de réciter.
Bonne chance !
Quelques plus.
Le travail d'une classe qui a "réécrit" le roman sous la forme de tweets.
Finalement, une réécriture qui ne trahit pas tant que cela le roman d'Albert Camus.
Le tweet et sa "sécheresse" servant assez bien l'apparente insensibilité de Meursautl.
L'adaptation au cinéma du roman L'étranger, d'Albert Camus (version anglaise, scène d'ouverture 1'10") par Luchino Visconti , une adaptation sans l'accord de l'auteur et qui, cinématographiquement, est jugée peu réussie.
Mais voir les premières images peut être intéressant pour s'interroger sur le travail d'adaptation d'une oeuvre écrite au cinéma (respect de la chronologie de la fiction, caractéristiques des personnes, etc...).
Une approche rapide a été proposée en classe.
Une présentation de l'oeuvre dans un format court : Miss Book